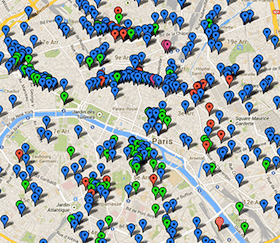Menacé de fermeture, le Festival des 3 Continents de Nantes relève le défi et passe le cap de 2010.
Avec une salle dédiée aux cinémas du monde, le Louxor proposera au public parisien un voyage dans la production cinématographique mondiale, dans le sillage du Festival des 3 continents de Nantes qui, depuis trente deux ans, sélectionne et débusque des trésors cinématographiques venus d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine. Rencontre avec son nouveau directeur artistique Jérôme Baron.
Votre programmation est dominée par le cinéma indépendant chinois, de jeunes cinéastes mexicains, paraguayens, c’est la nouvelle cartographie du cinéma du monde ?
 Depuis 20 ans, on a sur deux, voire une génération et demie, une proposition très forte de cinéma chinois qui est contemporaine d’un bouleversement dont on n’a pas encore pris la mesure et qui dépasse le cinéma : la Chine est en train de devenir la première puissance mondiale. Le pays vit des transformations extrêmement profondes en termes structurel, paysager, social, historique, culturel et la qualité de la production chinoise actuelle est de prendre la mesure de ces changements en cours, avec une conscience quasiment archivistique. Je crois que c’est un pays sur lequel on aura une archive d’une qualité absolument exceptionnelle quand on voudra voir le passage de la Chine communiste à la Chine capitaliste libérale et l’avènement de cette immense puissance. On aura la trace de cette transformation comme aucun pays n’était en mesure d’en témoigner jusque-là, dans ces proportions
Depuis 20 ans, on a sur deux, voire une génération et demie, une proposition très forte de cinéma chinois qui est contemporaine d’un bouleversement dont on n’a pas encore pris la mesure et qui dépasse le cinéma : la Chine est en train de devenir la première puissance mondiale. Le pays vit des transformations extrêmement profondes en termes structurel, paysager, social, historique, culturel et la qualité de la production chinoise actuelle est de prendre la mesure de ces changements en cours, avec une conscience quasiment archivistique. Je crois que c’est un pays sur lequel on aura une archive d’une qualité absolument exceptionnelle quand on voudra voir le passage de la Chine communiste à la Chine capitaliste libérale et l’avènement de cette immense puissance. On aura la trace de cette transformation comme aucun pays n’était en mesure d’en témoigner jusque-là, dans ces proportions
C’est un cinéma très esthétique, assez mélancolique qui parle d’une difficulté d’être, un thème également présent dans les autres films de la sélection notamment ceux d’Amérique Latine.
Étant donné ce qui se passe aujourd’hui, il y a un engagement très fort de ces cinéastes du monde entier et dans ces pays à prendre la mesure des réalités contemporaines sans pour autant minimiser l’état d’un imaginaire, comment le réel porte lui-même un certain nombre de récits mythologiques et initiatiques. Il y a une présence très forte d’un certain type de parole dans ces films.
C’est-à-dire ?
Les gens racontent des histoires, je pense au film colombien que j’aime beaucoup, Los Abrazos del Rio (L’étreinte du Fleuve) de Nicolas Rincon Gille, (Montgolfière d’Or). On a une tradition orale en Colombie qui est elle-même, si ce n’est menacée, quelque peu dissolue en ce moment ; le travail de Nicolas consiste à faire un recueil de ces mythes, contes, légendes et croyances populaires colombiennes en regardant quelle est leur place et ce qu’elles font résonner d’une inquiétude sur une actualité qui est beaucoup plus violente. Il y a une mise en tension comme cela d’un imaginaire poétique et symbolique avec un état de violence de cette société colombienne. Elle s’opère dans un lien très fort avec le paysage parce que cette parole est nourrie de cet environnement. Les légendes, les contes ou les manières de parler sont liés à un environnement précis, ils en incarnent le récit et l’explication par la magie de ces lieux. Mais la réalité est toujours en train de rattraper, voire de ronger, d’une certaine manière, la qualité de ces récits-là. Dans Los Abrazos de Rio, le fleuve Magdalena ne charrie pas uniquement les histoires d’un esprit qui s’appelle le Mohan et qui ordonne un peu le fleuve, mais il y a aussi les cadavres des gens exécutés par les militaires et jetés dans le fleuve… Donc la réalité finit par rencontrer le mythe parce que le Mohan avait pour objet de faire tomber les pêcheurs dans l’eau, de jouer de maléfices et, finalement, ce n’est pas le Mohan qui est la véritable menace. Le Mohan est quelque chose de magique auquel les gens se rattachent parce que cela donne un sens à leur réalité et ce sens est écrasé par une violence qui fait retour à ce que le fleuve charrie. On peut trouver des points communs avec d’autres films comme Novena de Enrique Collar (Paraguay).
Ce sont des films qui décrivent des situations difficiles.
Oui, il y a une sorte d’inquiétude. Ce que l’on propose, au Festival des 3 continents, c’est un état de ce que l’on a vu, à un moment donné, ce qui faisait sens en termes de proposition cinématographique et c’est vrai que l’on n’a pas vu beaucoup de comédies. Ce qui est intéressant, c’est de voir comment le documentaire est en prise avec le réel et l’imaginaire et, comment, la fiction invente des voies particulières, comment elle est en recherche d’un lien singulier pour parler de la réalité. La fiction et le documentaire se croisent, c’est là un des traits les plus singuliers.
Ce va et vient entre réalité et fiction est favorisé par le fait que les personnages ne sont pas joués par des acteurs professionnels mais par des personnes qui jouent leur propre rôle.
C’est une des raisons qui nous a conduit à ne plus séparer documentaire et fiction dans la programmation et la compétition. La création documentaire est essentielle à l’énergie du cinéma, la fiction se réalimente systématiquement à une source documentaire. Il y a des frottements et des interférences qui sont extrêmement productifs en termes d’invention formelle et de sens. Notre idée était de mettre face à face des films de fiction où l’empreinte documentaire est très forte et des documentaires où il y a une tendance à redécouvrir et redéployer des imaginaires, populaires ou autres. Par des voies différentes et de manière très libre, les documentaires et les fictions sont gouvernés par une recherche équivalente.
Cela donne des films très justes…
Oui, et Novena est un exemple de ces films sur ce point d’équilibre très fort : c’est une fiction tournée comme un documentaire. Il y a un travail de composition picturale dans le film parce que Enrique Collar est plus peintre que cinéaste et on retrouve comme cela une manière de réinjecter du corps, du mouvement, par la parole, dans la peinture. Ce sont des tableaux.
C’est un cinéma humble et modeste qui travaille avec peu de moyens dans un contexte de crise.
Les jeunes cinéastes d’aujourd’hui sont extrêmement doués, ils font comme beaucoup d’autres avant eux : les obstacles et les contraintes sont convertis en levier de création. Comme on n’est pas dans une pratique conventionnelle de cinéma, il faut inventer des formes, des énergies différentes de création. Et ces films-là sont assez exemplaires de cette originalité-là.
D’ailleurs, ces cinéastes n’ont pas forcément une formation cinématographique, ce sont des artistes, des peintres, des poètes et cela donne une richesse à leur production.
Je crois que pour faire du cinéma, il faut avoir des idées, après, la technique s’apprend. Tout le monde peut devenir, en travaillant, un technicien du cinéma. Après, pourquoi on convoque cette ressource, ce potentiel du cinéma ?, pourquoi on va faire du cinéma ? Les réponses sont variables, elles ne sont jamais les mêmes. Il y a un désir de cinéma, à un moment, puis, on passe à l’acte.
Vous avez aussi rendu hommage à une importante figure du cinéma d’Asie Centrale, le cinéaste ouzbek Ali Khamraev, qui a pu présenter cinq de ses films, dont The Seven Bullet, un très beau western à la Sergio Leone !
Oui, c’est un eastern, en fait ! Et puis ses autres films sont aussi totalement différents, c’est ce qui est fascinant chez Ali Khamraev. C’est un cinéaste totalement inconnu. Il a été montré un peu à Nantes, il y a quelques années, et aussi à Pompidou, mais Khamraev est un cinéaste très injustement ignoré, à 73 ans. Comme d’autres grands cinéastes originaires des anciennes provinces de l’Union soviétique, il a été formé au VGIK [Institut national de la cinématographie] de Moscou, qui était probablement la meilleure école du monde. Il appartient à la même génération que l’arménien Artavazd Pelechian et les russes Andreï Tartovski et Alexeï Guerman. Tous ces immenses cinéastes, indépendamment de leur différence, ont une intelligence formelle, à la fois théorique et technique, du cinéma ; on a donc d’emblée un niveau qualitatif minimum qui est au-dessus de la moyenne. Ali Khamraev a un parcours un peu particulier parce qu’il a dû faire des films de commande pour les Communistes mais il a négocié une sorte de jeu avec eux : il tournait un film de propagande, de commande et après, il faisait un film pour lui-même, et ces films d’auteur déplaisaient largement au pouvoir central et étaient censurés ou mis au ban. Mais même dans les films de propagande, il y a toujours un vrai exercice de style : The Seven Bullet est un film de commande mais il a toujours rêvé de faire un western parce qu’il adore John Ford, donc il a saisi l’occasion et l’on sent qu’il a pris un plaisir fou à faire ce film. C’est un cinéaste qu’il faut découvrir et redécouvrir absolument.
Dans le passé, le Festival des 3 Continents a fait découvrir des cinéastes inconnus à l’instar de Souleymane Cissé ou encore Abbas Kiarostami. Quels sont ceux qui pourraient sortir de l’ombre aujourd’hui ?
J’espère bien que ce sera le cas avec Khamraev dont les films vont être présenté prochainement au Lincoln Center de New York ; j’espère bien que la curiosité va être piqué à vif pour qu’on puisse montrer ses films plus largement à l’avenir. Khamraev devrait être à la Cinémathèque française, c’est un espace qui conviendrait parfaitement à une redécouverte de son œuvre.
Et parmi les jeunes réalisateurs chinois ?
Parmi les jeunes réalisateurs chinois, je mettrais l’accent sur un film qui donnait en quelque sorte le « là » de ce départ que l’on a identifié, c’est le film Xiao Wu, Artisan Pick Pocket de Jia Zang Khe, qui a reçu la Montgolfière d’or à Nantes en 1998 et c’était d’ailleurs sa première sortie de Chine. Dans la programmation de 2010, il y a ce film qui a été tourné en parallèle, entre 1997-2002, Estranged Paradise de Yang Fudong, un artiste plasticien qui fait peu de cinéma mais qui a, a priori, de nouveaux projets. Estranged Paradise est un film singulier dans le contexte du panorama du cinéma chinois aujourd’hui. C’est un film d’une valeur esthétique et poétique, un film merveilleux. Cela a été un gros coup de cœur.
Vous avez aussi consacré une rétrospective à l’œuvre de Djibril Diop Monbéty (Sénégal).
Monbéty est venu plusieurs fois à Nantes, c’était vraiment un ami du festival. Je suis très attaché à Monbéty, non parce qu’il est un cinéaste africain, car Monbéty est un cinéaste tout court. On a toujours montré un ou deux de ses films de manière très espacé ; l’idée, là, était de reprendre ses sept films car j’ai toujours eu cette impression que le film de Monbéty commençait en 1972 et finissait en 1980, comme un seul film qui se prolongeait, par bifurcation, sur 25 ans. Cela raconte toujours une histoire à peu prés équivalente : l’histoire des désillusions du post-colonialisme et, finalement, l’aliénation des classes populaires de Dakar à une vie qui est le gagne-pain quotidien, une existence soumise. Dans ces films, il montre comment ces points de tension évoluent tout en racontant toujours la même histoire. Ce qui change, c’est la manière dont il la raconte. C’est un cinéaste d’une force et d’une finesse passionnante.