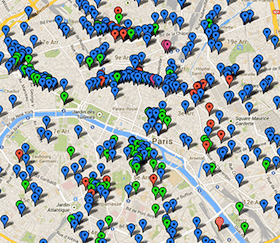La décoration du Louxor vue par Yan B. Dyl en 1921
Si la soirée d’inauguration du Louxor du 6 octobre 1921 fut presque parfaite [ici], le cinéma inauguré laissait encore dans le flou les historiens et les cinéphiles. En dehors de quelques clichés de presse en noir et blanc, quid de l’intérieur du lieu, de la grande salle ornée de peintures et motifs aux couleurs vives, que savons-nous du décorum flamboyant à l’égyptienne ? Ce mois d’octobre 1921, sous le titre « Architecture et décoration », un article conséquent dans la revue Le Courrier Cinématographique a attiré, notre attention lors de récentes recherches sur l’histoire du Louxor. Un certain Yan Bernard Dyl proposait à son lecteur une description vivante et précise… du cinéma le Louxor. Notre (en)quête était partiellement récompensée.
On ne pouvait se retenir de publier en intégralité cet article récemment exhumé par PARIS-LOUXOR et resté jusqu’ici inédit, écrit par un personnage haut en couleur, d’une culture diffuse et résistant dans l’âme. À vous d’imaginer le Louxor…
|
LE COURRIER CINÉMATOGRAPHIQUE ARCHITECTURE ET DÉCORATION
Un monument égyptien avec toute la gaité de ses couleurs vives, situé en plein Paris, ce rappel d’une Antiquité mystérieuse face au métro, prototype de construction moderne, appuyé à des maisons de cette facture vulgaire et impersonnelle dont nous ont dotés les cinquante dernières années, semble tout d’abord un défi à toutes les règles d’unité architecturale. Tout au moins de ces règles qui font une ville semblable à une autre, sans caractère local, dans des alignements de cordeau. Le public s’arrête, surpris, regarde : c’est un cinéma dont le nom lui-même, Louxor, est une évocation du passé. Certes, nous pouvons regretter pour cet ensemble de tonalités claires, les ciels joyeux de la vallée du Nil, où la lumière est une fête, qui seule peut les mettre en complète valeur. Mais il n’en est pas moins vrai que les lignes pures d’un temple thébain sont plus plaisantes à contempler que celles d’un monument nouveau-riche, style Potin-Dufayel [1]. D’autre part, attirer presque forcément l’attention du promeneur est un avantage publicitaire à ne pas négliger. Il serait inacceptable de rendre servilement le monument d’un autre âge. Ici, dès l’abord, l’adaptation est séduisante. Des soubassements de mosaïque, décoration de papyrus et de lotus, tels qu’on les trouve au temple d’Abydos y forment une aimable ornementation. Pourquoi faut-il qu’elles soient recouvertes déjà de quelques-unes de ces affiches, œuvres de gribouilleurs sans conscience, dont le moins qu’on puisse dire d’elles est que, faute sans doute d’une suffisante rétribution, elles sont le déshonneur d’une muraille. Au-dessus, le bâtiment s’enlève, blanc avec des rappels de vermillon et il ne manque même pas, à l’ensemble IXe dynastie, le mât de bois colorié qui s’accolait aux pylônes du temple de Khonsou et portait de longues banderoles de diverses teintes claquant dans le vent et le soleil. Vous entrez et tout ce qui, sur le boulevard, peut sembler anachronique s’efface, il ne reste que l’harmonie d’une salle spacieuse et aérée de forme cubique. Ici encore, tout est égyptien, mais les nécessités de la salle de spectacle ont voulu une adaptation moderne. Il en faut louer l’auteur de ne pas être tomber dans le travers commun de ses confères : la lourdeur trop riche, causée par la surabondance des moulures et des sculptures, pâtisserie aussi dorée qu’envahissante. Les couleurs sont réservées entièrement pour les parties hautes, elles s’estompent ainsi par l’éloignement et la perspective et créent une atmosphère de calme. Les soubassements ont été revêtus de marbre noir, veiné, moins accessible que la peinture aux injures du temps et des contacts. Cette masse sombre a également l’avantage de rejeter vers les régions supérieures les valeurs claires qui ont tendance, même dans la demi-obscurité de la projection, à concurrencer la luminosité de l’écran et fixent fâcheusement, durant les intervalles du programme, l’œil fatigué par une attention soutenue. Au-dessous du soubassement de larges piliers historiques plats en porphyre ocre, aux figures de bronze, inspirées du Sanaousrit [sic] de Karnak, soutiennent la frise supérieure composée dans le mode thébain. Des hommes à tête d’animaux présentés de profil s’y suivent sur un même plan horizontal ainsi que sur les figures murales de Karnak et d’Abydos et dans sépultures monumentales ou mastabas de l’époque memphitique. Peut-être au lieu d’imiter simplement ces frises, eût-on pu leur donner un caractère plus spécial à l’art de la visualité, mais telles qu’elles sont la sobriété des lignes et de la couleur en est heureuse et plaisante. Sur les parties plates de la muraille une ornementation peinte, heureusement moins touffue que celle du temple de Louxor ou celles des chambres funéraires de Saqqarah, se compose d’ornements purs, lignes géométriques, vertes, rouges, noires et bleues appuyées sur des colonnes lotiformes peintes de structure un peu grêle pour le module classique, mais qu’il eût été imprudent d’alourdir, le tout sur un fond crème. Autour de l’écran, un encadrement d’un polychromisme délicat, s’orne d’un store rubanné et d’une architrave encorbelle, également inspirés de Karnak. De chaque côté de la scène, deux portes symétriques ont emprunté leur forme et leurs détails à l’entrée du temple de Konsou. Le plafond décor, lui aussi polychrome de lignes géométriques, accueille dans son dessin d’époque ptolémaïque de larges plafonniers, par lesquels la lumière semble venir du dehors et tomber majestueuse et diffuse ainsi qu’il sied à la demeure des dieux. Je m’abstiendrai, par exemple, de louer certain rideau peint où prétend s’évoquer le portique ruiné du temple de Louxor ; outre qu’il est d’un coloris que nous avons assez vu à l’Opéra-Comique et ailleurs pour en être écœuré, il nous montre au bord du Nil d’étranges collines qui laissent un peu rêveurs. Et l’établissement possède un splendide rideau d’étoffe d’un goût trop pur pour nous exhiber cette pauvreté. Et, disséminé un peu partout, le motif ornemental du vautour aux ailes déployées de Nekhabit et d’Ouazit [sic], emblème de domination universelle (quelle force domine plus que la vision ?) est comme le sceau d’une époque. Nous le retrouverons sur la partie supérieure des soubassements, soutenant les frises et les balcons, dominant les portes, la scène et l’orchestre, monstrueuse gueule de porphyre rose d’où s’échappent des harmonies, jusque sur les fauteuils d’acajou sombre et dans la forme décorative des lampes suspendues. Voici, en résumé, un effort décoratif particulièrement intéressant, en ce qu’il cherche dans une note curieuse et délicate à traiter, à s’inspirer des nécessités du spectacle visuel par un plan général intelligemment conçu. Il sera intéressant de poursuivre dans un style résolument moderne cette recherche d’adaptation. Le cinéma peut être un assez grand art pour mériter des formules neuves adéquates à sa psychologie. Nous essayerons prochainement de jeter les bases pouvant régir ces ensembles décoratifs. Une salle de spectacle est un temple dédié au culte de l’art et de la beauté. Il mérite un style personnel et ne doit pas être le bric-à-brac d’un somptueux mauvais goût que nous montrent trop de salles de théâtre et de cinéma. Yan B. Dyl Le Courrier cinématographique, daté du 29 octobre 1921, n°44, p. 33-34. |
Qui est Yan B. Dyl ?
Illustrateur Art Déco méconnu, artiste peintre à ses heures, paysagiste et dessinateur cubiste, Yan Bernard Dyl – dont le vrai nom est Yan Bernard Morel, né le 8 juin 1887 – était un proche du peintre cubiste Robert Delaunay et fut l’un des représentants du mouvement Art Déco. On lui connaît la réalisation de plusieurs couvertures et illustrations de livres avec de belles pointes-sèches, comme Les Oraisons amoureuses de Jeanne-Aurélie Grivolin, Lyonnaise de Roger Pillet (La Connaissance, Paris, 1926) ou encore La danse macabre de Pierre Mac Orlan (Simon Kra, Paris, 1927). Yan Bernard Dyl est aussi l’auteur d’un livre d’illustrations La petite ville (Simon Kra, Paris, 1926), ouvrage synthétisant la vie d’une petite ville de province, de plusieurs publicités pour des joailliers parisiens et d’une très belle publicité murale pour l’apéritif Campari, publicité qui couvrira les immeubles parisiens en 1929. L’histoire a également retenu qu’il a co-réalisé en 1922 un film intitulé La Conquête des Gaules, racontant les difficultés d’un metteur en scène devant, avec peu de moyens, réaliser un grand film sur la conquête de la Gaule par les Romains.
Dans les années 30, Yan Bernard Dyl s’intéresse à l’érotisme et publie avec Pierre Louys un Manuel de Civilité pour les Petites Filles à l’usage des Maisons d’Éducation (Simon Kra, Paris, 1926), puis sera reconnu comme l’auteur d’une série de photos intitulée « Problèmes et solutions sur les éléments de mécanique sensuelle », alors qu’il se revendique « Docteur en Sciences érotiques ». On ne connaît guère plus de sa vie. Arrêté en 1943 par l’occupant, il meurt le 4 décembre 1944 à Buchenwald, déporté pour faits de résistance. Il a 57 ans.
[1] Les galeries Dufayel, premier grand magasin à rayonnages, se trouvent boulevard Barbès, presque en face du Louxor à cette époque, d’où cette référence. Ayant conservé sa façade monumentale, le bâtiment est aujourd’hui occupé par la BNP. Quant au siège de Félix Potin, de style identique, il se situe à l’angle de la rue Réaumur et du boulevard Sébastopol à Paris.
À lire : Les commentaires de l’architecte Philippe Pumain.